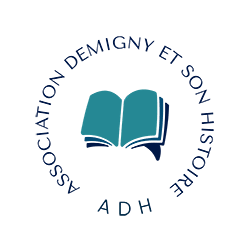Biographie de René PAILLARD (1915-1983)
(extraits)
René Paillard naît à Fourchambault (Nièvre) le 22 mars 1915.
Ecoles fréquentées
Après l’école publique de garçons de Charnay-Lès-Mâcon d’octobre 1920 à Avril 1921, il fréquente successivement, d’avril 1921 à juillet 1927, l’école publique de garçons de Romenay (reçu au certificat d’études primaires le 29 juin 1927), puis d’octobre 1927 à juillet 1932, grâce à des bourses, le cours complémentaire de garçons de Mâcon (reçu au diplôme commercial de comptabilité le 27 juillet 1930 avec la mention bien puis au brevet d’enseignement primaire supérieur, section générale, le 21 juillet 1932).
Formation, titres et postes occupés
Entré à l’Ecole Normale d’instituteurs de Mâcon en octobre 1932, il en sort en juillet 1935 avec les diplômes suivants : certificat d’aptitude à l’éducation physique (degré élémentaire) le 3 juin 1935, Brevet Supérieur à Mâcon le 5 juillet 1935. Intérimaire à Autun, rue Mazagran, du 1er au 22 octobre 1935, il épouse le 18 avril 1936 Marcelle Goudard (née à Chaudenay le 3 janvier 1915, sans profession) dont il aura quatre enfants : Gérard, Marie-Jeanne, Michel et Françoise. Il est ensuite stagiaire à Demigny du 1er octobre au 31 décembre 1937 et obtient le Certificat d’Aptitude Pédagogique le 10 décembre 1937. Il est instituteur titulaire à Demigny à partir du 1er janvier 1938.
Etat de services militaires
Il a effectué son service militaire du 24 octobre 1935 au 1er octobre 1937 ; sous-lieutenant le 10 avril 1936 puis lieutenant de réserve le 5 octobre 1938, il est mobilisé au 134e R.I.M. le 26 août 1939 ; aux armées le 2 septembre, il est fait prisonnier le 29 mai 1940 à Lille. Il demeure en captivité en Silésie, au camp Oflag IV D de Hoyerswerda, au nord-est de Dresde, près de la frontière polonaise, jusqu’au 23 avril 1945, date à laquelle il est libéré par les Russes. Rapatrié le 2 juin, en convalescence jusqu’au premier juillet, il est démobilisé le 3 juillet 1945 et sera nommé capitaine de réserve le 1er décembre 1950.
L’enseignement agricole
Après la guerre, il reprend sa classe de cours élémentaire à Demigny et s’intéresse à l’enseignement agricole.
Les premiers cours agricoles du soir, pour adultes ont été créés en 1887 et sont délivrés par les instituteurs ruraux. L’Ecole pratique d’agriculture et de viticulture de Fontaines a ouvert le 30 juillet 1892 et celle de Charolles le 17 novembre 1931. Un enseignement postscolaire agricole pour les jeunes de 14 à 17 ans est institué le 5 juillet 1941 et nécessite la création en 1942 d’un Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Agricole (CAEA). M. Paillard obtient ce diplôme le 26 septembre 1946 à Mâcon. Ils seront 19 enseignants à prodiguer cette formation en Saône-et-Loire. Le premier octobre 1947, il est nommé instituteur itinérant chargé de cours agricoles puis professeur à compter du 9 janvier 1951. Résidant à Demigny jusqu’en 1949 puis à Chaudenay à partir de 1950, il délivre cet enseignement postscolaire dans plusieurs « centres » reconnus officiellement par la direction des Services Agricoles et qui regroupent un grand nombre des villages du secteur : de 9h à 12h et de 14 h à 17 h, à Givry le lundi, Virey-le-Grand le mardi, Demigny le mercredi, Chagny le vendredi et à l’Ecole d’Agriculture de Fontaines le samedi, ceci de 1947 à 1969.
Cet enseignement conduit au certificat d’études postscolaires agricoles (CEPSA valant CAP) et au Brevet d’Aptitudes Agricoles Professionnelles (BAAP) devenu Brevet d’Apprentissage Agricole à partir de 1969.
M. Paillard donne entre autres activités des cours de greffage de la vigne et d’arboriculture. Dans son compte-rendu d’inspection du 24 janvier 1950, l’inspecteur primaire P. Juillet conclut son rapport ainsi : « Instituteur sérieux. Monsieur Paillard donne avec autorité un enseignement solide et ordonné ; il a aussi le souci de la bonne formation morale des jeunes gens qui lui sont confiés. Il accomplit dans la région qu’il visite un travail extrêmement fructueux ». Le 24 mars 1953, l’inspecteur est encore plus élogieux : « M. Paillard est un de nos meilleurs maîtres itinérants agricoles. Il donne avec compétence et dévouement un enseignement qui profite non seulement aux jeunes gens qui lui sont confiés, mais encore aux cultivateurs de la région, avec lesquels il entretient des rapports suivis. Son influence est indéniable en ce qui concerne l’amélioration des pratiques culturales et de l’élevage, l’emploi des engrais et des produits de défense des végétaux, la motorisation agricole. Je tiens à lui adresser mes compliments et mes encouragements ».
Après la suppression des cours postscolaires, il donne, à partir du 15 septembre 1969, des cours au CES de Chagny et au collège agricole de Fontaines (12 heures par semaine dans chaque établissement, cours de biologie animale et végétale, dessin industriel). Il prend sa retraite en juin 1970.
Mandats électifs
Entré en mars 1959 au conseil municipal de Chaudenay, il assure les fonctions de 2ème adjoint sous le mandat de M. Jean Roucher-Sarrazin, maire. Il est ensuite régulièrement réélu au poste de maire de 1963 à 1983. Il préside avec méthode et rigueur au développement, à l’aménagement et à l’embellissement de sa commune : remembrement et travaux d’hydraulique agricoles, création de la zone artisanale et du lotissement contigu, de celui des Petits Vergers, chauffage de l’église et électrification des cloches, réorganisation de l’ancien cimetière et ouverture du nouveau, assainissement, agrandissement de la mairie, aménagement de trottoirs et de la place Montfort, fleurissement de la commune, etc.
Il décède le 23 janvier 1983.